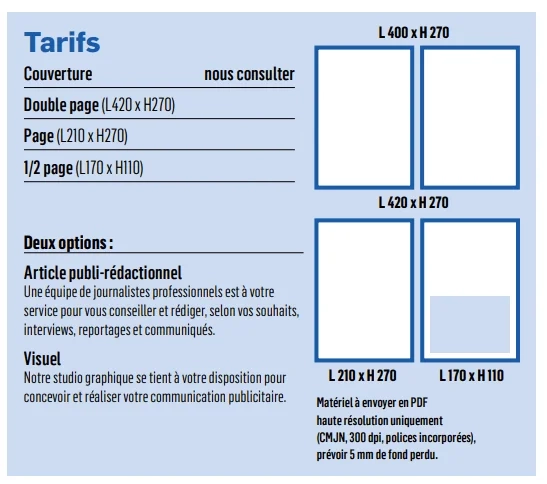Entretien avec Bolidja TIEM, Ministre de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise, depuis octobre 2020. Il occupait auparavant la fonction de Directeur Général de l’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER).
Où en est l’avancement de la feuille de route donnant l’accès des populations aux services d’eau potable inscrit dans l’axe stratégique 3 du PND ?
Le Gouvernement nourrit l’ambition de garantir le service social de base qu’est l’accès à l’eau potable, défini comme un droit fondamental par les instruments juridiques et internationaux, et mis en œuvre à travers une planification rationnelle des investissements et la gestion du service.
Dans cette optique, sur la base de l’ODD 6 et du Plan National de Développement (PND) notamment, le Gouvernement s’est doté d’une Feuille de Route (FdR) stratégique 2020 – 2025 en vue d’assurer un accès à l’eau potable de 85% en 2025 au plan national avec 95% d’accès à l’eau potable en milieu rural, 85% en milieu semi urbain, 75% en milieu urbain hors Lomé et 80% dans le Grand Lomé et converger vers 100% à l’horizon 2030.
Pour atteindre ces objectifs à l’horizon 2025, plusieurs actions ont été menées au titre de l’année 2021. Ces actions ont permis de desservir de l’eau potable à environ 413 817 personnes supplémentaires, faisant alors passer le taux de desserte de 60% en 2020 à 61,53% en 2021 soit un progrès de 1,53%.
En tenant compte du milieu de résidence, ce taux est passé de 68,13% à 69,49% pour le milieu rural, de 53% à 52,88% pour le milieu semi-urbain et de 57,57% à 60,25% pour le milieu urbain. Les réalisations présentées par milieu de résidence
ci-après ont permis d’enregistrer ces progrès. Il s’agit de :
Pour le milieu rural
La réalisation et équipement de 219 nouveaux forages PMH, 89 postes d’eau autonomes et 10 mini-adduction d’eau potable sommaires. Ceci a permis de desservir environ 93 890 personnes supplémentaires. Ce qui a fait passer le taux de desserte en milieu rural de 68,13% 2020 à 69,49% en 2021.
Pour le milieu semi urbain
Au cours de l’année 2021, les travaux dans ce milieu ont permis de réaliser 59 PMH, 31 PEA et 10 MINI-AEP. Ces réalisations ont permis d’offrir de l’eau potable à près de 57 643 personnes supplémentaires.
Le taux de desserte dans ce milieu a connu une légère régression passant de 53% en 2020 à 52,88% en 2021. Cette régression est due au fait que les réalisations ne sont pas suffisantes comparativement à l’accroissement démographique galopant.
Pour le milieu urbain
Au titre de l’année 2021, les réalisations dans ce milieu ont concerné essentiellement les travaux de branchements privés domestiques (BP), les extensions de réseau et les renforcements des capacités de cellules de production et de stockage d’eau potable.
Au total, 254,213 km linéaires de réseau posés, 19 908 nouveaux BP ont été réalisés, 2 châteaux d’eau de capacité de stockage de 1000 m3 et 15 bornes fontaines ont été construits. Ces réalisations ont permis de desservir une population supplémentaire de 262 284 habitants faisant passer le taux de desserte de 57,57% en 2020 à 60,25% en milieu urbain en 2021.
Plusieurs actions sont en cours et en vue avec l’appui de plusieurs PTF dans les trois (3) milieux pour améliorer davantage ces taux. C’est notamment : les projets PEAT1 & PEAT2 avec l’UE ; le Projet d’amélioration de l’alimentation en eau potable de la ville de Lomé-Phase 2 sur financement de l’AFD et UE ; le Projet d’amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural des régions des Savanes et de la Kara (PASSCO 2) avec l’AFD ; le Projet d’Alimentation en Eau Potable des centres semi-urbains du Togo (PAEPCSU) ; le PND-EAU ; le Projet de Renforcement et d’Extension des Systèmes d’Alimentation en Eau Potable des villes de Agou Gadzepe, Blitta ; le Projet d’alimentation en Eau Potable de la ville de Kara et ses environs ; les travaux d’urgence de réalisation de forages et les travaux de forages sur les ZAAP (Zones d’Aménagement Agricoles Planifiées), etc.
En outre, des réformes et des mesures ont été opérées au cours de l’année 2021 pour améliorer la gouvernance du secteur afin d’accélérer l’atteinte des résultats de la FdR d’ici 2025. Il s’agit notamment de : l’actualisation des contrats de performances et de contrats plans (en cours de signature) ; de l’élaboration du Plan d’Investissement (en cours de finalisation) ; la création du Comité de Suivi des contrats ; la mise en place de la cellule de suivi des projets du ministère de l’eau et de l’hydraulique villageoise (CSP-MEHV) ; l’institution des redevances de prélèvement d’eau et le cadrage de l’activité de foreur dans l’application du code de l’eau ; l’institution des réunions bihebdomadaires pour les projets en souffrance avec tous les acteurs concernés ; la relance de la coordination d’actions entre toutes les parties prenantes du secteur pour aligner les activités aux objectifs de la feuille de route ; l’initiation des projets créateurs de valeur économique tels que le projet pilote de compteurs prépayés en cours (10 000 unités) ; la définition d’une stratégie d’accès pour tous à l’eau et à l’assainissement d’ici 2030 ; l’identification des partenaires multi et bilatéraux pour le financement des projets du secteur, etc.
Comment gérez-vous la maintenance des installations ?
Le Ministère a mis en place depuis 2009 une base de données PROGRES. Elle permet de suivre les données administratives, techniques des ouvrages et de suivre la qualité de l’eau fourni aux populations notamment en milieu rural. En ce jour, la base de données PROGRES contient 12 021 ouvrages.
Pour un suivi à temps réel et la maintenance des ouvrages hydraulique, le MEHV, avec l’appui du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, a développé en 2019 une plateforme de « Suivi des Ouvrages de Forage et des Indicateurs pour l’Eau » dénommé SOFIE basé sur la téléphonie mobile. La plateforme SOFIE vient compléter la base de données PROGRES notamment dans le suivi des pannes. SOFIE suit aujourd’hui, l’état de fonctionnement de 9 064 ouvrages. Le processus d’intégration des ouvrages restant à la plateforme SOFIE est en cours afin de prendre tous les ouvrages en compte pour le suivi. Cette plateforme, permet de visualiser à temps réel sur une carte l’état de fonctionnement des ouvrages à travers la couleur de l’ouvrages : Rouge (déclaration de panne par le comité eau), Bleu (prise de commande de réparation par l’artisan réparateur), Orange (confirmation de la prise de commande de réparation par l’agent de suivi des ouvrages) et Vert (confirmation de la réparation par le comité eau).
L’objectif de la plateforme SOFIE est de faciliter les échanges entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des forages afin de réduire la durée de réparation des pannes et les coûts d’exploitation des forages. Cette plateforme permet de détecter les pannes en temps réel, déclencher rapidement les interventions de dépannage dès la notification des pannes, collecter et archiver les résultats des interventions de dépannage et les statistiques.
La plateforme SOFIE est basée sur une technologie mobile. Chaque forage est identifié par un numéro de téléphone qui lie les différents acteurs qui interagissent pour le bon fonctionnement du forage. Une fois qu’un forage tombe en panne, un membre du comité appelle le numéro vert 1020 pour signaler la panne. Ainsi le processus semi-automatisé pour permettre la réparation rapide des ouvrages est déclencher. L’artisan réparateur reçoit un SMS qui lui notifie que le forage est en panne et procède à la réparation. La vérification de l’effectivité de la réparation est suivie par un agent de suivi des ouvrages et qui rend compte à la hiérarchie. Si le processus est suivi normalement, le forage est réparé dans les 72 heures qui suivent. Après ce délai, le système se charge d’envoyer automatiquement un message au Sociologue et au Directeur Régional de l’hydraulique pour signaler le forage hors délai de réparation. Le Sociologue tout comme le Directeur se charge d’appeler hors système les différents acteurs afin de procéder à la réparation rapide du forage. La disponibilité des pièces de rechange dans les magasins des régions et préfectures permet de respecter le délai de réparation fixé par le MEHV. La plateforme SOFIE produit les données sur l’état de fonctionnement des ouvrages d’AEP, les statistiques de déclaration de panne, les statistiques sur la durée de mise en état des ouvrages et sur la répartition géographique des ouvrages. En ce qui concerne la réparation, les membres du comité eau gèrent les petites pannes et l’État à travers les projets réhabilite les forages nécessitant de grand investissement.
Quelles opportunités s’offrent au Togo à travers son adhésion à la Convention sur l’eau ?
Le Togo, comme la plupart des autres pays du monde, d’Afrique et principalement de la sous-région Ouest africaine, partage la plus grande partie de ses ressources en eau tant de surface que souterraines avec d’autres pays, à savoir : le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Mali pour ce qui concerne le bassin du fleuve Volta représenté au Togo par l’Oti ; le Bénin, pour le bassin du fleuve Mono ; le Ghana, le Bénin et le Nigeria, pour ce qui concerne le bassin sédimentaire et le système lagunaire côtiers. Ainsi, la gestion et l’utilisation de ces ressources en eau constituent donc un enjeu stratégique. Il apparaît nécessaire de coopérer avec les pays voisins conformément aux dispositions légales nationales et aux conventions internationales fixant le cadre juridique dans lequel les pays partageant des ressources en eau transfrontières peuvent coopérer pour assurer le développement et préserver la stabilité régionale. Ainsi, la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, étant un instrument important pour promouvoir davantage la coopération aussi bien aux niveaux sous régional qu’international et coordonner la gestion rationnelle, impartiale, durable et non conflictuelle des ressources en eau transfrontières, le Gouvernement n’a ménagé aucun effort pour y faire adhérer le Togo.
Autorisé par l’Assemblée Nationale le 11 mai 2021 à adhérer à cette Convention, le Togo est devenu officiellement, le 27 décembre 2021, la 46ème Partie et le 5ème Etat Africain à adhérer à cet important instrument juridique international. L’adhésion du Togo à cette Convention vise non seulement à soutenir les efforts entrepris par les pays d’Afrique de l’Ouest dans la gestion durable de leurs ressources en eau mais aussi revêt plusieurs enjeux stratégiques :
• l’amélioration de la gestion de l’eau au niveau national : l’application des obligations de la Convention notamment celle relative à la prévention, au contrôle et à la réduction des impacts transfrontières significatifs améliorant la gestion de la ressource en eau au niveau national ;
• la contribution à la paix et à la sécurité internationales : la participation et la coopération au sein de la plateforme intergouvernementale de la Convention aident à prévenir d’éventuels désaccords, tensions ou différends, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
• l’accès à l’aide financière et à la coopération des donateurs : l’adhésion à la Convention accroît les chances d’accéder aux financements extérieurs pour les projets concernant l’utilisation, la gestion et la protection des ressources en eau transfrontières. Les pays membres de la Convention peuvent également bénéficier du fonds d’affectation spéciale qui soutient la mise en œuvre effective de la convention ;
• le partage des connaissances et des expériences : les pays membres bénéficient de la diffusion des bonnes pratiques, de l’apprentissage mutuel et de l’expérience acquise au titre de la convention dans divers domaines : problèmes d’inondations, de sécheresse, de sécurité des barrages, de gestion commune des infrastructures hydrauliques, de répartition de l’eau entre l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation et la production d’énergie ;
• le soutien à la coopération bilatérale et au niveau des bassins : la Convention apporte son soutien à ses membres pour la mise en place d’accords et la création d’organes communs pour les bassins spécifiques ainsi que pour le renforcement de ceux existants. Alors que les autorités des bassins de la Volta (ABV) et du Mono (ABM) sont opérationnelles ou en phase de l’être, le système aquifère du bassin sédimentaire côtier reste toujours sans aucun arrangement transfrontalier. La Convention sur l’eau peut contribuer significativement à la mise en place d’un accord pour ce bassin également ;
• la reconnaissance de la part de la communauté internationale : en devenant partie à la Convention sur l’eau, l’Etat Togolais indique aux autres pays, aux organisations internationales, aux institutions financières ainsi qu’aux autres acteurs sa bonne volonté de coopérer sur la base des critères et normes de la convention. Il s’agit d’un écho politique et diplomatique non négligeable qui suscite un regard favorable et une considération empreinte de respect de la part de la communauté internationale ;
• la participation au développement de la Convention ainsi que du droit international en matière d’eau : lors des réunions des organes directeurs de la Convention, tout Etat membre peut engager la négociation sur de nouveaux instruments juridiques et peut aussi décider de l’interprétation de la Convention.


















 A Seat That Transforms into a Bed
A Seat That Transforms into a Bed  In the world of air travel, economy class is often considered the most affordable option. However, at Air Afrika, we believe that affordability shouldn't mean compromising on quality of service. Our class
In the world of air travel, economy class is often considered the most affordable option. However, at Air Afrika, we believe that affordability shouldn't mean compromising on quality of service. Our class